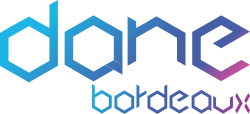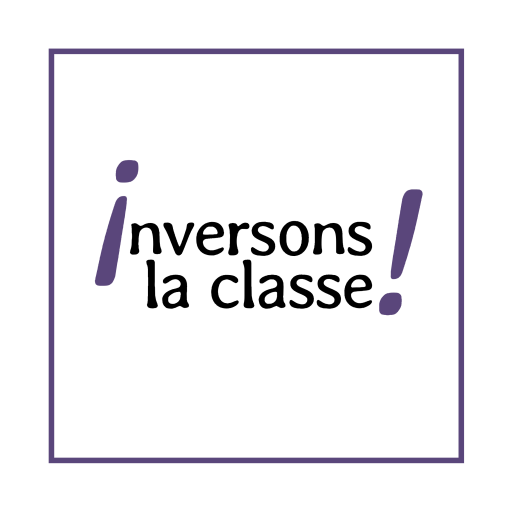Eidos 2019
Pour sa onzième édition, Eidos64 reste fidèle à sa vocation de temps d’échange et de partage sur les pratiques numériques en éducation. Organisée par le Département des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec l’Éducation nationale, cette journée est destinée à tous les acteurs de l’éducation (enseignants de la maternelle au supérieur, chefs d’établissements, chercheurs, collectivités, parents d’élèves…).
Édition 2019 : En classe, je joue donc je suis ? Ludification des apprentissages
Le lien entre jeu et apprentissage ne va pas de soi ; qu’on songe par exemple à tous ces élèves à qui on reproche de « s’amuser en classe »… Pourtant, l’adjectif ludique est toujours mélioratif quand il est question d’apprentissage et les enseignants sont souvent invités de nos jours à proposer une approche plus ludique à leurs élèves.
Jouer pour suivre en classe
Le jeu est largement utilisé pour les plus jeunes enfants, c’est ainsi, par l’imitation, par le plaisir de la manipulation qu’ils peuvent faire les premiers apprentissages dans tous les domaines. Si on y recourt de moins en moins au fur et à mesure que les élèves grandissent, il n’en reste pas moins un moyen puissant pour intéresser les jeunes et les sensibiliser à des questions auxquelles ils n’auraient pas naturellement prêté attention, un moyen de « faire passer la pilule » en les faisant travailler sans qu’ils s’en rendent compte sur des sujets ardus. Comment alors ne pas penser à Lucrèce, qui compare, au livre IV du De natura rerum, sa poésie à du miel utilisé pour faire prendre un remède amer à un enfant ?
« Quand les médecins veulent donner de la répugnante absinthe aux enfants, ils commencent par enduire les bords de la coupe d’un miel doux et blond, pour que leur âge imprévoyant soit trompé [qui traduit le verbe « ludificetur »], jusqu’aux lèvres, et boive en entier, entre-temps, le liquide amer […]. »
N’est-ce pas précisément la démarche proposée : rendre amusant un contenu rébarbatif pour que les élèves le reçoivent avec moins de répugnance ? La question qui se pose est alors de savoir où placer la limite : les acquisitions permises par le jeu sont-elles à la mesure du temps passé à jouer ? Le risque n’est pas mince en effet que le jeu ne soit un prétexte à délayer les apprentissages, à éluder les vraies questions. En outre, le jeu, par sa facilité, peut être attrayant pour tous les élèves, même ceux qui sont en difficulté face aux apprentissages, mais n’y a-t-il pas un risque que ces élèves-là, justement, demeurent à sa superficie, sans jamais percevoir les savoirs ou les messages qu’il est censé faire passer comme ce collégien qui expliquait que Scratch (utilisé pour l’apprentissage de la programmation) est ‘une application pour faire bouger un chat’. Le rôle de l’enseignant est alors primordial pour aider les joueurs à porter un regard réflexif sur le jeu auquel ils viennent de s’adonner afin de les aider à identifier selon les cas, les apprentissages réalisés, les compétences mises en œuvre, les besoins identifiés, les messages véhiculés, les valeurs sous-jacentes aux règles du jeu, les transferts ou les suites possibles
L’écueil opposé existe aussi : à force de vouloir être sûr que l’élève apprend, l’enseignant ne va-t-il pas faire perdre au jeu toute dimension ludique ? Le jeu sérieux, à force d’être sérieux, ne s’expose-t-il pas à devenir un jeu sévère (pour reprendre le titre d’un livre de Michael Maier, Jocus severus, 1617) ? Est-il utile de citer tous ces jeux sérieux qui n’ont de jeu que le nom et qui n’amusent que leurs créateurs ? Certains élèves ne gagneraient-ils pas à consacrer ce temps à un travail plus « scolaire » ?
On peut aussi, sans utiliser véritablement un jeu, s’inspirer dans l’enseignement des mécanismes des jeux : retour immédiat sur les actions, gratification, capitalisation de points, badges,valorisation de la démarche par essai-erreur, reprise illimitée d’un exercice jusqu’à la réussite, rôle au sein d’une équipe… On entre alors dans ce qu’on appelle, au sens strict, la ludification (ou gamification). Là encore, il faut se demander ce qu’on veut apprendre et si le moyen ne devient pas une fin en soi.
Ce procédé est massivement utilisé dans le marketing. Le designer Jesse Schell a créé le blog Gamepocalypse now où il recensait des exemples de mise en œuvre de ce système. Certains cas sont seulement curieux ou ridicules, comme la brosse à dents connectée qui fait gagner des points quand on l’utilise, ou des jeux qui accordent des points aux habitants d’un logement quand ils font le ménage, les mettant en concurrence pour que chacun participe. D’autres sont beaucoup plus inquiétants. La dernière publication sur le blog Gamepocalypse now date de 2015 et est consacrée au dispositif Sesame credit, mis en place en Chine. Jesse Schell estime que ce système constitue l’avènement de la Gamepocalypse qu’il annonçait. Il s’agit en quelque sorte de ludifier la citoyenneté : quand ils publient des informations sur les réseaux sociaux en faveur du gouvernement ou quand ils font des achats de produits chinois, les participants gagnent des points ; en revanche, s’ils prennent des positions défavorables ou achètent des produits venant de l’étranger, ils en perdent. Le score ainsi obtenu permet de bénéficier d’avantages dans la vie quotidienne : facilité pour obtenir un prêt ou des documents administratifs, par exemple. Mais en ne voyant le jeu que comme un système de récompenses, ne passe-t-on pas à côté de l’essentiel ? N’est-il pas vrai que, comme le dit Mathieu Triclot, une gamification ainsi conçue, « qui s’accompagne souvent d’un éloge du pouvoir des jeux et des joueurs, repose en réalité sur un mépris total du médium, réduit à des mécaniques pavloviennes » (Philosophie des jeux vidéo, 2011) ?
Apprendre à jouer
Ces exemples dystopiques sont évidemment extrêmes et ne concernent pas des applications pédagogiques du jeu. Ils montrent toutefois qu’au-delà de cette utilisation comme un moyen d’apprentissage, ou un prétexte, le jeu peut aussi être abordé comme un objet d’étude, pour en faire un usage raisonné et savoir en tirer le meilleur parti. Il est reconnu en effet que le jeu, en particulier certains jeux vidéos, permet le développement de la créativité, celui de différentes compétences : lecture rapide d’informations dans un environnement instable, travail collaboratif etc. C’est ainsi que certains ont pu défendre l’idée de développer une ludolittératie (Ludoliteracy: defining understanding and supporting games education).
D’ailleurs, la production de jeux vidéos est devenue une industrie culturelle qui n’est guère différente du cinéma (pour ne citer que deux blockbusters, le jeu Call of Duty: Modern Warfare 2, sorti en 2009, a le même budget que le film Harry Potter et le prince de sang mêlé, sorti la même année : 250 millions de dollars). Dès lors, pourquoi ne pas considérer le jeu comme une œuvre artistique, qui possède son intrigue, son univers graphique, son vocabulaire, ses références, au même titre qu’un film ? Bien sûr, tous les jeux ne se prêtent pas à une analyse très approfondie, mais n’est-ce pas aussi le cas de certains films ? Est-ce que l’école n’a pas aussi pour mission de fournir des repères aux jeunes dans l’offre culturelle à laquelle ils sont confrontés ? Et si le jeu vidéo possède ses propres codes, il utilise aussi des procédés narratifs et stylistiques des arts plus communément étudiés à l’école.
Dans le même ordre d’idées, les jeux vidéos peuvent être des vecteurs puissants pour l’éducation aux médias, en amenant par exemple les élèves, conduits par leurs enseignants, à s’interroger sur les stéréotypes qu’ils véhiculent.
Jouer pour être
Toutefois, le jeu joue incontestablement un rôle plus fondamental. Les enseignants qui s’y essaient notent la plupart du temps qu’il donne l’occasion à beaucoup d’élèves de participer, même parmi ceux qui sont habituellement peu actifs en classe. Certains, qui se croient exclus de la classe par leurs difficultés, retrouvent, grâce à l’accessibilité et l’universalité du jeu, une place active et motrice qu’ils ne peuvent pas avoir dans des activités plus « académiques ». Ainsi, le jeu leur permet d’être en classe, au même titre que les autres. Mais ncourt-on pas le risque aussi que ceux qui ne réussissent pas dans le jeu soient exclus ?
Pour certains, l’activité ludique est intrinsèquement liée à l’apprentissage et le goût du jeu est avant tout un goût de l’apprentissage. Le game designer Raph Koster peut ainsi écrire :
« Les jeux sont une nourriture concentrée que nous donnons à mâcher à notre cerveau. Abstraits et iconiques, ils sont aisément absorbés. […] D’ordinaire, nos cerveaux ont un dur travail à accomplir pour transformer une réalité confuse en quelque chose d’aussi clair qu’un jeu. Les jeux servent d’instrument fondamental et très puissant d’apprentissage. »
(A Theory of Fun for Game Design, 2005, cité par Mathieu Triclot, Philosophie des jeux vidéo).
Mais au-delà de cet « être en classe », c’est peut-être quelque chose de plus général qui se joue dans ce processus. Qu’on se souvienne de Winnicott :
« C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité tout entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi. »
N’est-il pas alors approprié de dire « je joue, donc je suis » ?
Serio ludere : l’esprit d’Eidos64 ?
On peut néanmoins penser que le jeu n’est qu’une diversion futile, une façon pour l’enseignant de se tromper et de tromper les élèves, en les occupant à des activités qu’ils apprécient, pour éviter d’avoir à affronter le véritable effort nécessaire à l’apprentissage, que bien loin d’être un moyen pour les aider à suivre, il constitue une fuite face à la difficulté (« je joue, donc je fuis »). Peut-être faut-il alors se souvenir de Montaigne qui écrivait : « [Je] m’instruis mieux par contrariété que par exemple, et par fuite que par suite. »
C’est aussi pour nous l’occasion de faire le lien avec le serio ludere cher aux Humanistes de la Renaissance et auquel on fait souvent référence quand il est question de jeux sérieux. Marsile Ficin (1496) déclare ainsi :
C’était la manière habituelle de Pythagore, Socrate et Platon, de couvrir en toute occasion de figures et de voiles les divins mystères, de dissimuler modestement leur sagesse, contrairement à la jactance des Sophistes, de plaisanter sérieusement et de jouer savamment [iocari serio, et studiosissime ludere].
Ce parallèle avec la Renaissance nous amène à deux remarques.
La première, plus générale, est qu’il faut relativiser la notion de jeu, de rire, de plaisanterie, dans le temps et dans l’espace : ce qui fait rire les uns n’est pas toujours ce qui fait rire les autres et ce qui amuse un enfant n’est pas forcément ce qui amuse un adulte. Qui rirait aujourd’hui aux austères allégories et aux âpres emblèmes que les Humanistes considéraient comme du serio ludere ?
La seconde concerne Eidos64 même. Le jeu proposé par les auteurs des XVIe et XVIIe siècles est bien souvent un jeu sur les mots, un jeu de références subtiles, au travers duquel on s’efforce d’entrevoir la vérité. Or n’est-ce pas précisément ce qu’est Eidos64 ? Outre la dimension superficielle, mais essentielle, du moment de plaisir partagé utilisé pour apprendre, n’est-ce pas aussi le pas de côté pour mieux saisir un sujet qui caractérise cette journée ? Quand nous nous demandons comment rendre l’élève hacker de ses apprentissages, pour qu’il en soit acteur et qu’il en soit au cœur, quand nous posons la question de savoir si la résistance à l’innovation est (f)utile, quand nous cherchons à « apprendre autrement avec/sans/par/malgré le numérique », n’est-ce pas une façon par le jeu (de mots) de soumettre les évidences à la question et par là-même d’essayer d’accéder à une autre vision des choses ? Aussi, il nous semble que le thème de cette année touche à l’essence même d’Eidos64, par une sorte de vertigineuse mise en abyme.